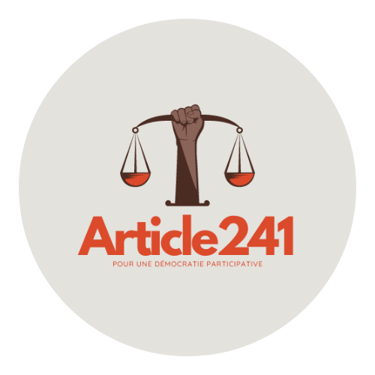Référendum au Gabon : que se passe-t-il si le « NON » l’emporte ?
Un électeur qui se pose la question du processus en cas de victoire du "NON" nous partage sa réflexion sur le sujet.
11/13/20242 min read


Quatorze mois après le coup d’État du 30 août 2023, les Gabonais sont appelés aux urnes pour se prononcer sur la révision constitutionnelle portée par les autorités. Les militaires au pouvoir ont fait de la modification de la Constitution leur cheval de bataille ; les électeurs trancheront le 16 novembre. Néanmoins, si on sait ce qu’il adviendra si le nouveau texte est adopté, le flou demeure sur la suite des événements si le « non » l’emporte. Or, il semble important, pour faire un choix éclairé, de savoir ce qu’il implique.
Les deux camps ont longtemps affûté leurs armes avant de se lancer ce 7 novembre dans la campagne référendaire. Chacun, à coups d'arguments, essaye de convaincre la majorité des 850.000 électeurs gabonais, d'insérer le bulletin vert avec la mention « oui » ou le bulletin rouge signé « non ». C'est la deuxième fois de son histoire qu'un référendum est organisé au Gabon. Le premier s'était déroulé en 1995 pour ratifier les accords de Paris, ouvrant ainsi la voie à une modification de la Constitution. Il s'agissait déjà de créer un cadre pour la transformation des institutions en établissant l'État de droit : le « oui » l'avait emporté à 96,48%.
Si la majorité des électeurs votent « oui » comme en 1995, le Gabon aura sa nouvelle Constitution. La vie publique s'organisera autour de ce texte ; les institutions devront respecter ses 173 articles.
À contrario, si le « non » convainc la plupart des électeurs, la suite reste pour le moment un mystère, les autorités publiques ne s'étant pas clairement prononcées sur le sujet. Y aura t-il une enquête pour déterminer les raisons qui ont conduit au « non » afin d'amender le texte et le soumettre une nouvelle fois au peuple ? Revient-on tout simplement à la dernière version de la Constitution de 1991, modifiée neuf fois entre 1994 et 2023 ? Les réponses à ces deux questions peuvent avoir une incidence non négligeable sur la psychologie de l'électeur au moment de prendre sa décision.
Deux scénarios déterminants
En effet, si l'électeur pense qu'il y aura des modifications post-scrutin, il y a fort à parier qu'il soit dans une démarche de maximisation. Pourquoi se contenter de ce projet, si on peut travailler à avoir la meilleure version possible ? Ainsi, dans l'examen du texte, il sera pointilleux et porté à vouloir l’améliorer. Si on peut supprimer tel aspect, préciser telle disposition, ajouter tel article, c'est optimal, il faut corriger toutes les failles. Le premier scénario implique un choix qui se ferait entre le présent projet de Constitution et une Constitution idéale.
Dans le cas où il faudra simplement revenir à la Constitution en vigueur si le « non » l'emporte, l'électeur pourrait aborder le processus avec un état d'esprit différent. Plus susceptible d'avoir une lecture comparative des textes, il cherchera à faire des compromis, pèsera peut-être le pour et le contre sur chaque disposition et fera ainsi son choix. Cette fois, la question sous-jacente serait de savoir quelle Constitution il préfère, parce qu'en définitive, c'est soit l'une, soit l'autre.
Selon l'option, l'électeur a deux approches distinctes parce que les deux questions en filigrane le sont. Dans la première, on lui demande de choisir entre ce qu'on lui propose et son idéal. Dans la seconde, il est limité, il a deux réponses prédéfinies, il ne peut pas aller plus loin.
Lire la suite sur le blog de John NZENZE