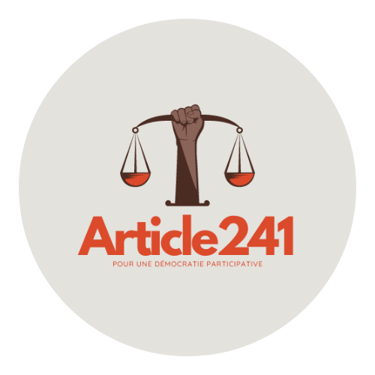LIVRE II, TITRE I :
Les articles 167 à 187
Analyse du TITRE I, LIVRE II du Code Électoral
Après un scrutin majoritaire en deux tours, le président de la République est élu pour sept (7) ans au suffrage universel direct. Il est rééligible une seule fois et ne peut faire plus de deux mandats successifs quels que soient les futurs changements apportés à la Constitution. Son conjoint et ses descendants ne peuvent pas lui succéder (art. 170).
En cas de vacance de la Présidence de la République ou d'empêchement définitif de son titulaire (art. 171), le Président du Sénat ou son vice-président si le premier est empêché, assure l'intérim et ne peut se présenter à l'élection présidentielle.
Parmi les critères d'éligibilité (art.170), le candidat, âgé de 35 ans au moins à 70 ans au plus, doit avoir la nationalité gabonaise exclusive. S'il en possède une autre, il doit y renoncer au moins trois (3) ans avant le scrutin.
Trois (3) ans, c'est aussi la période minimale pendant laquelle il a l'obligation de résider sur le territoire national avant de se présenter à la présidentielle. De plus, le candidat doit être marié à une personne gabonaise, née d'au moins un parent gabonais, lui-même né Gabonais.
Entre autres, le candidat doit attester de la maîtrise d'une langue nationale en présentant une déclaration d'aptitude linguistique délivrée par le ministère de la Culture (art.179).
Le dossier de candidature, déposé au ministère de l'Intérieur doit également comporter un certificat médical sur son état de bien-être mental et physique, ainsi qu'une quittance de paiement au Trésor de la caution de trente millions (30.000.000) de francs CFA (art. 179).
Dès l'ouverture de la campagne électorale (14 jours avant le scrutin), l'organe de régulation de la Communication s'assure que tous les candidats reçoivent le même traitement médiatique concernant (art.180) :
le temps d'antenne
l’espace d'insertion dans les sociétés du secteur public de télévision, de radio et dans la presse écrite
la couverture dans les programmes d'information des sociétés du secteur public.
Toutefois, le Président en exercice garde les avantages liés à sa fonction (sécurité, transport, infrastructures d'accueil appartenant à l'État).
Après avoir reçu les procès-verbaux des commissions provinciales et consulaires, le ministre de l'Intérieur en annonce les résultats. La Cour constitutionnelle contrôle la régularité des opérations électorales (art. 186 et 187).
Avis de la Rédaction Article241
Le 2 décembre 1967, Omar Bongo est devenu président de la République gabonaise. Il occupe ce poste sans discontinuité jusqu'au 8 juin 2009, date de sa mort. Son fils, Ali Bongo, devient président le 16 octobre 2009, jusqu'au coup d'État du 30 août 2023. Ils totalisent ainsi 56 ans de règne.
Les dispositions empêchant le conjoint et les descendants du président de la République de lui succéder et interdisant au président de faire plus de deux mandats successifs, s'inscrivent dans ce contexte. Elles tendent ainsi à prévenir toute dérive dynastique de l'exécutif en favorisant l'alternance. En ce sens, elles sont une avancée.
Néanmoins, plusieurs facteurs d'exclusion demeurent, en témoigne premièrement le montant de la caution. Fixé à trente millions (30.000.000) de francs CFA, il est en inadéquation totale avec les réalités économiques du Gabonais moyen.
Environ 40% de la population vit sous le seuil de pauvreté (3.500 francs CFA/jour). Une autre (grande) partie, des agents publics aux salariés du secteur privé, n'est pas en mesure de trouver simplement ces fonds sans s'endetter durablement.
C'est une mesure restrictive qui est susceptible d'éliminer la grande majorité des Gabonais, tout en favorisant les plus nantis et ceux qui ont un parti politique puissant qui les soutient. Un système de parrainage et une caution revue à la baisse auraient été plus pertinents.
Il est légitime de s'interroger sur la pertinence de la maîtrise d'une langue ethnique pour accéder à la magistrature suprême. La langue administrative étant le français, le chef de l'État dans l'exercice de sa fonction, n'a pas la nécessité d'en comprendre parfaitement une autre. Cela ne devrait donc pas constituer un obstacle.
À moins de mettre en place des critères objectifs attestant un niveau suffisant de maîtrise d'une langue, ce critère pourrait ne dépendre que de l'appréciation subjective des examinateurs du ministère de la Culture. Il est important, a autant que faire se peut, d'éviter toute forme d'arbitraire dans la désignation des candidats.
D'autres verrous s'ajoutent à la porte de la Présidence de la République. Il s'agit entre autres de la nationalité du conjoint du candidat, ainsi que celle du parent de ce dernier. Là encore, c'est une condition qui n'a aucune incidence sur la gouvernance et qui, en outre, restreint la liberté de la candidature. Il n'est pas prouvé qu'il existe un lien entre la compétence d'un individu et la nationalité de son épouse, de son mari ou de ses beaux-parents.
Quand on évoque l'âge maximal pour se porter candidat, la question de l'état de santé apparaît souvent en filigrane. On veut par ce moyen écarter ceux qui sont considérés inaptes physiquement et moralement à diriger. Or, c'est précisément pour s'assurer du bien être physique et moral du candidat qu'il y a une visite médicale, indépendamment de son âge. Et si la visite médicale remplit ce rôle, il ne semble pas nécessaire d’ajouter un second filtre.
Concernant l'égalité du traitement médiatique, il serait indispensable de rendre la surveillance et le contrôle plus justes, plus strictes. Lors du référendum constitutionnel du 16 novembre 2024, la campagne du « Oui » avait débuté bien avant celle du « Non ». Il y a eu de même plus de reportages en faveur du premier choix que du second. Il y a une nécessité à corriger ces irrégularités qui entachent la justice et l'équité du scrutin. Un candidat lésé aura le droit de se questionner sur les conséquences de l'injustice médiatique dans le résultat final.